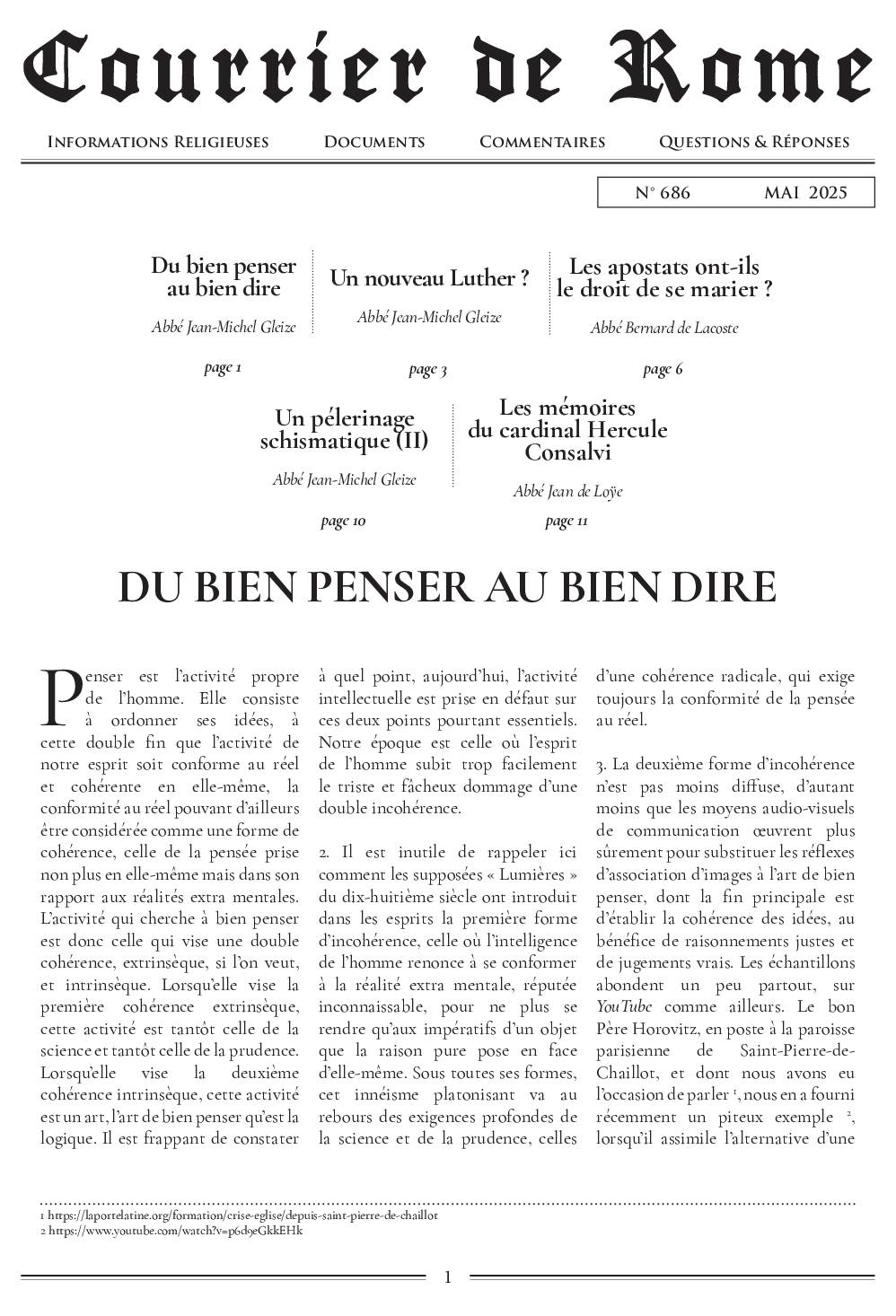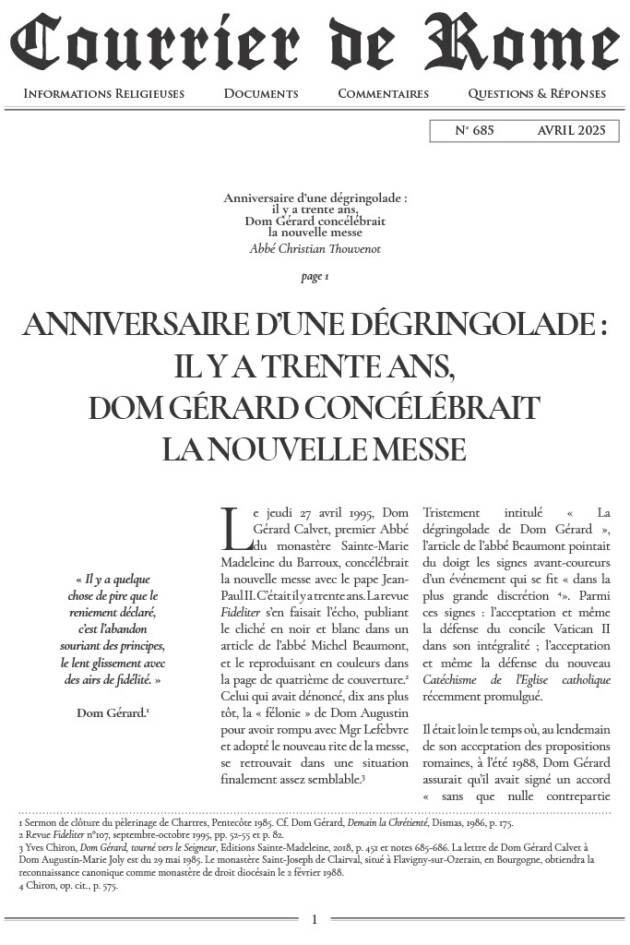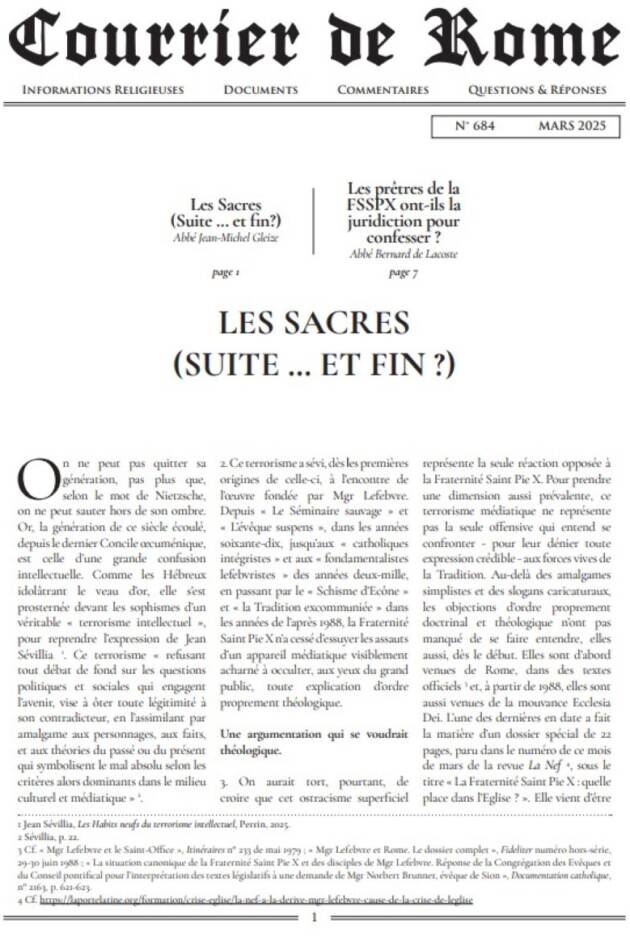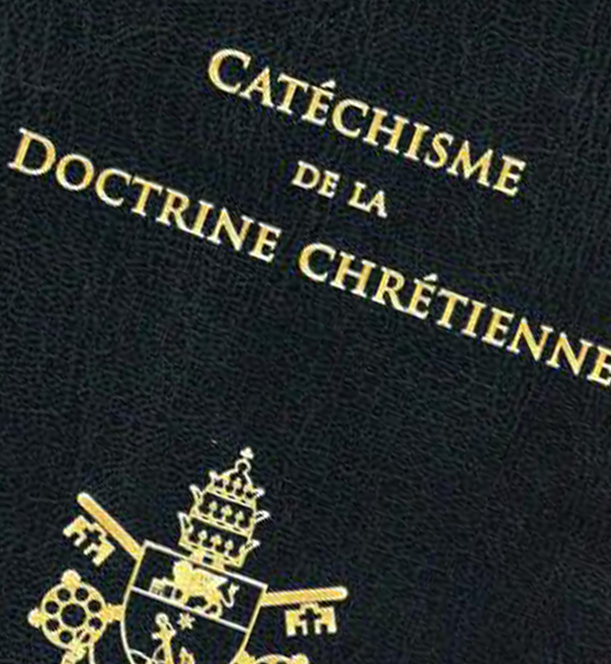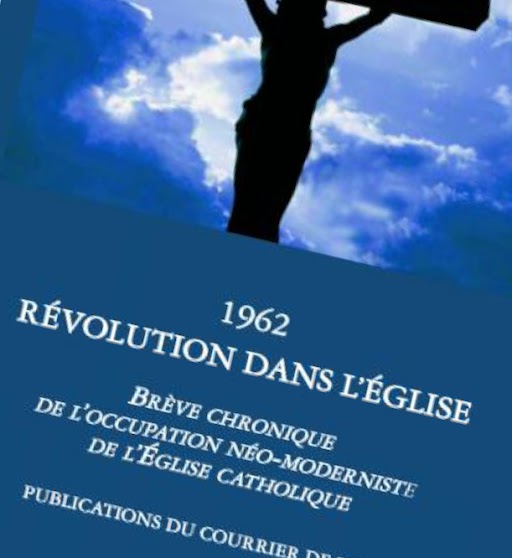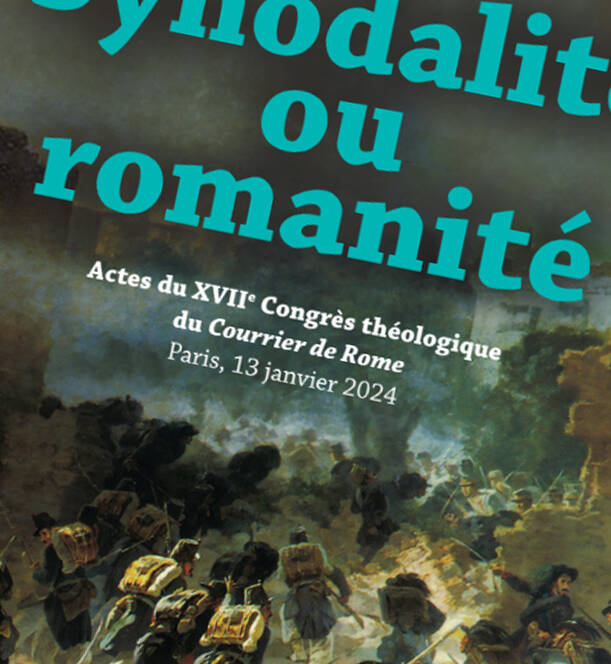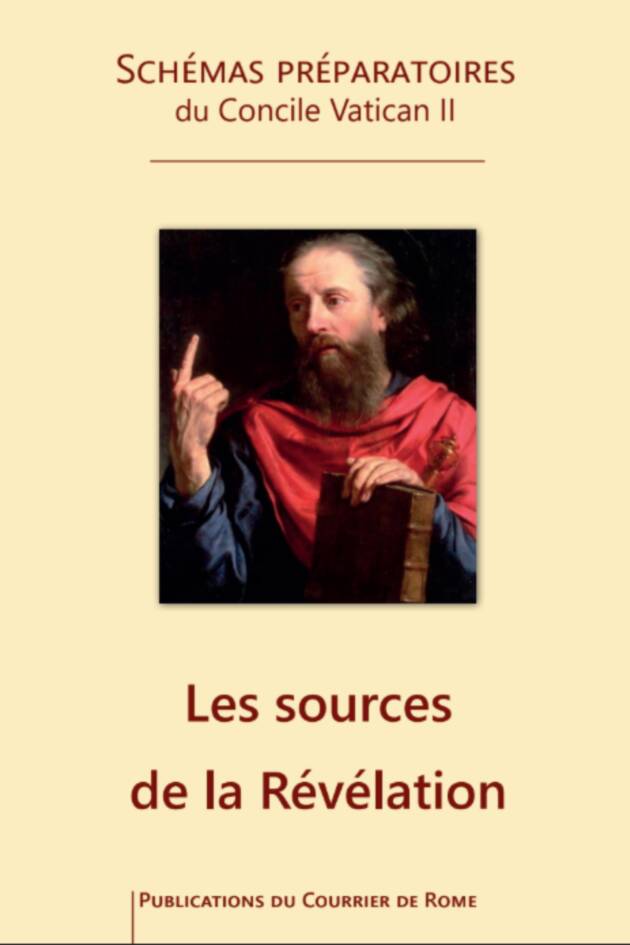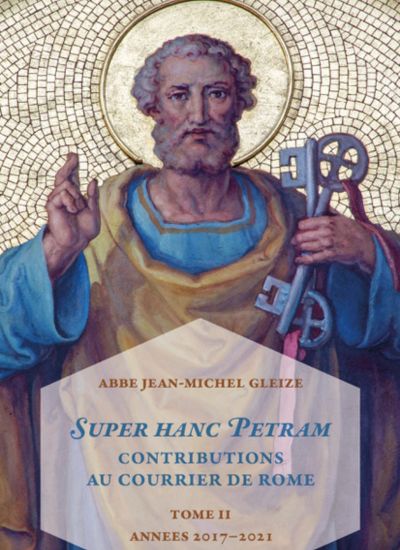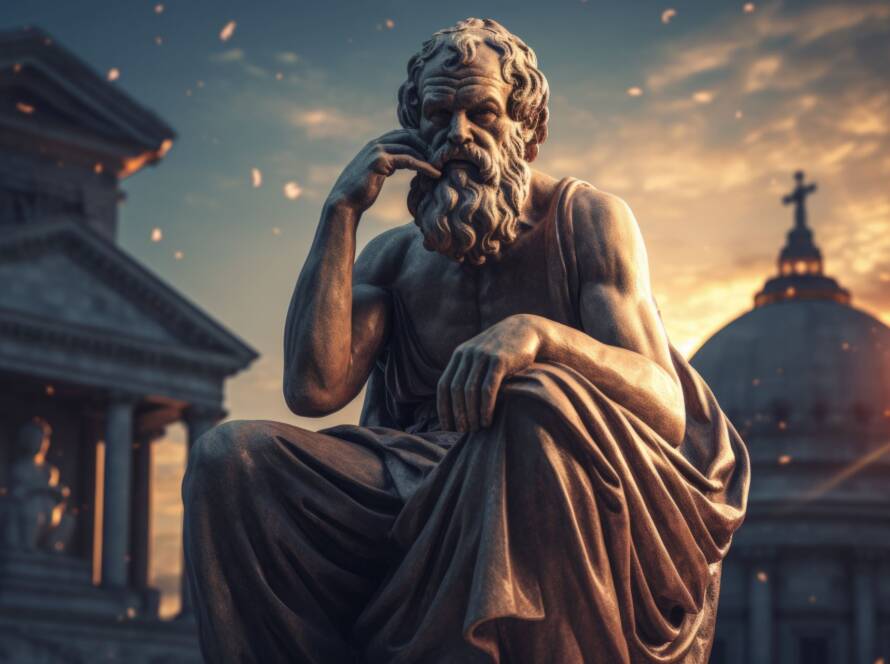Un demi-siècle
au service de la vérité
Le Courrier de Rome, fondé en 1967, éclaire les fidèles en défendant la doctrine immuable de l’Église face aux attaques progressistes.
Par des analyses précises et des réfutations rigoureuses, il offre un guide sûr pour discerner la vérité et rejeter l’erreur.
Depuis 1988, avec plus de 50 ouvrages publiés et des congrès internationaux reconnus, le Courrier de Rome reste un phare dans la tempête de la crise ecclésiale.
Nos derniers numéros
-
0,00€ – 4,00€ Buy now Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
-
0,00€ – 4,00€ Buy now Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
-
0,00€ – 4,00€ Buy now Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Ecriture sainte, tradition et magistère...
Tout pour fortifier votre foi !
Nos derniers ouvrages
Faites un don !
Votre soutien est indispensable pour préserver et promouvoir un espace de réflexion et d’échange intellectuel de qualité. Grâce à vos dons, nous pouvons :
- Publier des travaux de recherche approfondis et accessibles au plus grand nombre.
- Organiser des colloques et congrès internationaux, essentiels pour faire avancer les idées et enrichir les débats.
- Offrir des ressources éducatives pour un public diversifié.
Chaque don renforce la diffusion des savoirs et la rigueur de la pensée.
- 50 € permettent de financer deux abonnements gratuits pour des religieux.
- 100 € contribuent à payer 40 timbres à 100g pour l’envoi de la revue.
- 500 € financent les frais d’impression pour un numéro du CDR.
En apportant votre contribution, vous devenez un acteur essentiel de cette mission. Rejoignez-nous dans cette quête de vérité et d’excellence intellectuelle.