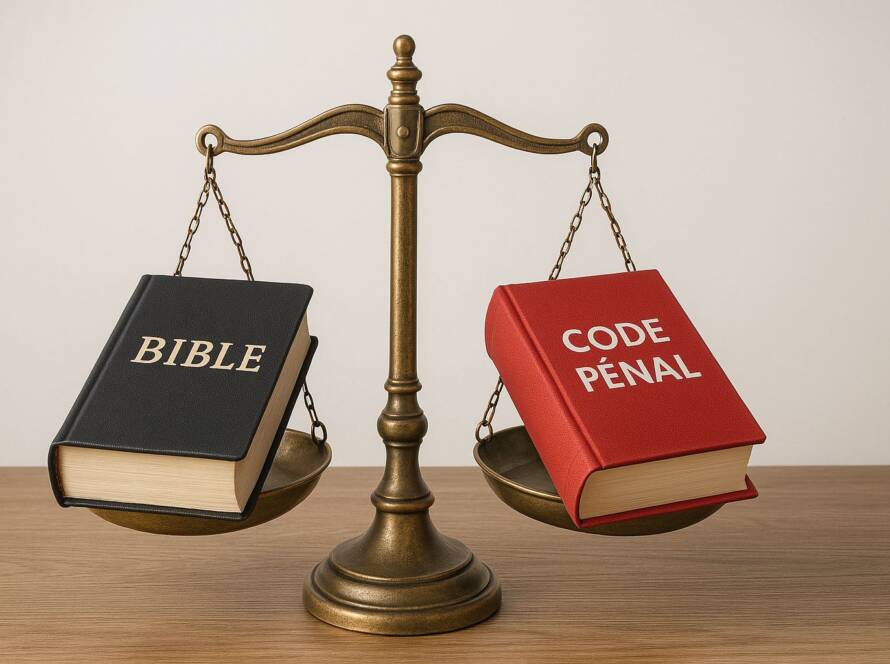– I –
Une appréciation encore indécise
1. Depuis son élection au Souverain Pontificat survenue le 8 mai dernier, le successeur de François est demeuré relativement sobre et discret, au sens où il ne s’est pas franchement exprimé, ni pour rectifier ni non plus pour donner toute leur confirmation à certaines des orientations plus qu’étonnantes prises par son prédécesseur. Deux points ont en effet suscité une certaine part de désarroi dans le Peuple de Dieu, ou du moins dans la frange plutôt conservatrice de celui-ci. Plus d’un, parmi les inconditionnels de Jean-Paul II, ont été fort mécontentés de l’ouverture autorisée tant par l’Exhortation apostolique Amoris laetitia en 2016 que par la Déclaration Fiducia supplicans en 2023 [1]. Plus d’un aussi, parmi les inconditionnels de Benoît XVI, ont été tout aussi fortement mécontentés du manque d’ouverture et des restrictions imposés par le Motu proprio Traditionis custodes en 2021 [2]. Ces silences et cette réserve du nouveau Vicaire du Christ nourrissent les attentes les plus différenciées, chez tous les déçus – et même plus que déçus : exaspérés – de François.
2. La question posée en filigrane par Jean Pierre Maugendre, dès le 13 mai 2025, sur le site de « Renaissance catholique » [3] résume assez bien les choses : Léon XIV sera-t-il le Pape de l’espérance ? La réponse se veut, dans un premier temps, d’un optimiste circonstancié : « On n’a pas deux fois l’occasion de faire une première bonne impression ! L’adage est connu et recèle une bonne part de vérité. Sous cet aspect le nouveau pape Léon XIV semble accomplir un parcours sans faute. Quelques minutes après son élection il est apparu au balcon de la basilique Saint-Pierre revêtu de la mozette rouge, de l’étole pontificale et d’une croix pectorale dorée, manifestement conscient du sens de la dignité pontificale dont il était désormais revêtu. […] En choisissant le nom de Léon XIV le nouveau pape renoue avec l’histoire longue de l’Eglise, par-delà les noms des papes (Jean XXIII et Paul VI) du concile Vatican II et de l’après concile (Jean-Paul I et II), la lignée des François étant, à ce jour, sans postérité. […] Les premières prises de parole publiques du nouveau Pontife ont frappé par leur envergure intellectuelle, leur verticalité, leur caractère surnaturel et leur tonalité résolument christocentrique, n’hésitant pas à traiter de l’Eglise comme arche du salut ce qui n’a, bien sûr, rien à voir avec le fait que la diversité des religions serait une sage disposition de la volonté divine ». Mais le Président de Renaissance catholique reste mesuré : « Chacun, maintenant, s’efforce de savoir quelles seront les orientations majeures du pontificat. Si certains points semblent acquis (bienveillance vis-à-vis des migrants néanmoins sans les outrances de son prédécesseur, exercice d’un pouvoir pontifical moins solitaire, volonté d’écoute, dévotion mariale) de nombreux autres sujets restent ouverts ». En effet, Léon XIV ne nous a pas encore tout dit.
– II –
Du paraître à l’être
3. Sans doute, oui, y a-t-il ici, dès les premiers instants du nouveau Pontificat, une question d’image de marque – ou de paraître, et il faut bien reconnaître que celle-ci revêt, dans le contexte, toute son importance, après douze années au cours desquelles le comportement médiatique du Pape François finissait par retirer à la fonction pontificale une part toujours plus grande de sa crédibilité. On ne peut que se réjouir de voir apparaître un successeur de saint Pierre visiblement conscient de la dignité hors du commun que lui confère son élection. Mais, au-delà du paraître, il y a l’être. Et les déclarations du nouveau Pape ont malheureusement déjà de quoi nous permettre de craindre, sans trop nous tromper, que l’orientation de Léon XIV, si elle se différencie de celle de François au niveau du paraître et de l’image représentative, reste foncièrement celle des faux principes de Vatican II au niveau de l’être même de la nouvelle ecclésiologie, œcuméniste et indifférentiste. Tout autant que François, Léon XIV apparaît déjà comme le fils et l’héritier du dernier Concile.
– III –
L’ecclésiologie de Léon XIV
4. Le 19 mai 2025, dix jours à peine après son élection, le Pape Léon XIV a voulu adresser un discours « aux représentants d’autres églises et communautés ecclésiales » [4]. Il insiste sur l’urgence de la démarche œcuménique, en cette année qui doit marquer le mille sept-centième anniversaire du premier concile œcuménique de Nicée. L’unité œcuménique précise-t-il, « ne peut être qu’une unité dans la foi » et d’ajouter : « En tant qu’Évêque de Rome, je considère comme l’un de mes devoirs prioritaires la recherche du rétablissement de la pleine et visible communion entre tous ceux qui professent la même foi en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit ». La foi serait-elle donc la même, alors que la communion – ou l’unité – n’est pas encore pleinement rétablie ? Cela peut s’entendre si l’unité à réaliser est autre que l’unité dans la foi. Mais tel n’est pas le cas, puisque, selon le Pape, cette unité doit se faire dans la même foi : comment peut-il soutenir, dès lors, que la foi est déjà la même, alors que l’unité n’est pas encore pleinement rétablie ?
5. La même problématique se retrouve dans le Discours que le Pape a voulu adresser, le 7 juin dernier, aux participants au Symposium « Nicée et l’Eglise du troisième millénaire : vers l’unité catholique-orthodoxe », réunion d’étude qui s’est tenue à l’Université Pontificale Saint-Thomas-d’Aquin [5]. Citant le document élaboré par la Commission théologique internationale à l’occasion du mille sept-centième anniversaire du concile de Nicée, le Pape déclare que l’année 2025 représente « une occasion inestimable de souligner que ce que nous avons en commun est beaucoup plus fort, quantitativement et qualitativement, que ce qui nous divise ». En effet, continue-t-il, « ensemble, nous croyons au Dieu Trinitaire, au Christ vrai homme et vrai Dieu, et au salut par Jésus-Christ, selon les Écritures lues dans l’Église et sous la motion de l’Esprit Saint. Ensemble, nous croyons en l’Église, au baptême, à la résurrection des morts et à la vie éternelle ». Et d’ajouter : « Je suis convaincu qu’en revenant au Concile de Nicée et en puisant ensemble à cette source commune, nous pourrons voir sous un autre jour les points qui nous séparent encore ». Quels sont ces points ? Le Pape n’en dit rien. Il se contente de répéter que « en célébrant ensemble cette foi de Nicée et en la proclamant ensemble, nous avancerons aussi vers la restauration de la pleine communion entre nous ». Mais de quelle communion peut-il s’agir ? Et quelles sont les divisions qui doivent être surmontées pour y parvenir ?
6. Recevant à Rome, le 28 juin, une délégation du Patriarcat orthodoxe de Constantinople [6], le Pape rappelle l’idée déjà introduite dans les textes du concile Vatican II et réaffirmée sans cesse par les déclarations de la Congrégation pour la Doctrine de la foi, de Paul VI à Benoît XVI : l’Eglise orthodoxe de Constantinople est « une église sœur » et « cet échange traditionnel de délégations entre les deux Eglises à l’occasion des fêtes respectives des saints patrons est le signe de la profonde communion déjà existante entre nous et est le reflet du lien de fraternité qui unit les apôtres Pierre et André ». Et de rappeler son intention « de persévérer dans l’effort pour rétablir la pleine communion visible entre nos Eglises ».
– IV –
Une ecclésiologie inacceptable
7. Comment entendre tous ces rappels, qui ne font que traduire les enseignements du concile Vatican II, spécialement les principes faux du Décret Unitatis redintegratio sur l’œcuménisme [7] ? Quelques indices nous sont fournis par les différentes déclarations du Pape, dans les discours précités : compris à la lumière du Décret de Vatican II, ils peuvent donner un sens à la démarche de Léon XIV.
8. Dans le Discours du 7 juin, le Pape précise en effet que « l’unité à laquelle les chrétiens aspirent ne sera pas d’abord le fruit de nos efforts ni ne se réalisera à travers un modèle ou un plan préconçu ». Citant la prière composée par l’un des pionniers de l’œcuménisme, le Père Paul Couturier [8], le Pape ajoute que « l’unité sera plutôt un don reçu » comme le Christ le veut et par les moyens qu’il veut « , par l’action de l’Esprit Saint ». Et dans le Discours du 19 mai, il explique que « notre communion se réalise en effet dans la mesure où nous convergeons vers le Seigneur Jésus. Plus nous lui sommes fidèles et obéissants, plus nous sommes unis entre nous ». Enfin, dans le Discours du 28 juin, il précise que la communion parfaite doit être atteinte « à travers un engagement constant d’écoute respectueuse et de dialogue fraternel ». Si nous comprenons bien, l’unité dont il s’agit est le fruit d’une dynamique imprévisible, fondée sur l’action de l’Esprit Saint qui passe par le dialogue et l’écoute réciproque. Pourtant, le Pape Léon XIII, dans l’Encyclique Satis cognitum de 1896, rappelle que « l’Église a été fondée et constituée par Jésus-Christ Notre-Seigneur ». Il s’ensuit de là que, contrairement à ce qu’affirme Léon XIV, l’unité des chrétiens doit se réaliser à travers un modèle et un plan préconçu : le modèle et le plan établis par le propre Fils de Dieu, fondateur de l’Eglise. « Par conséquent », continue Léon XIII, « lorsque nous nous enquérons de la nature de l’Église, l’essentiel est de savoir ce que Jésus-Christ a voulu faire et ce qu’il a fait en réalité. C’est d’après cette règle qu’il faut traiter surtout de l’unité de l’Église ».
9. L’unité inventée de toutes pièces par Vatican II est tout autre et c’est pourquoi ce ne serait être ni l’unité des chrétiens, ni celle de l’Eglise du Christ. En effet, dit Léon XIII, toujours dans Satis cognitum, « l’auteur divin de l’Église, ayant décrété de lui donner l’unité de foi, de gouvernement, de communion, a choisi Pierre et ses successeurs pour établir en eux le principe et comme le centre de l’unité. […] De là vient cette sentence de saint Cyprien, que l’hérésie et le schisme se produisent et naissent l’une et l’autre de ce fait, que l’on refuse à la puissance suprême l’obéissance qui lui est due. « L’unique source d’où ont surgi les hérésies et d’où sont nés les schismes, c’est que l’on n’obéit point au Pontife de Dieu et que l’on ne veut pas reconnaître dans l’Église et en même temps un seul pontife et un seul juge qui tient la place du Christ » (Lettre 12 à Corneille, n° 5) ». Cette unité de l’Eglise est donc identiquement celle de l’Eglise du Christ et celle de l’Eglise catholique romaine, sans qu’il y ait aucune distinction, ni réelle ni même de raison entre les deux [9]. Car l’unité de l’Eglise
résulte d’un principe voulu par le Christ. Ce principe qui manquera toujours à toutes les communautés séparées de l’Eglise, quelle que soit la part quantitative ou qualitative qui peut leur être commune avec les catholiques, est un principe surnaturel, parce que divinement institué : c’est le bien de la profession extérieure de la vraie foi et du vrai culte, mais tel qu’il est atteint sous le gouvernement hiérarchique du Pape, chef suprême, et des évêques, chefs subordonnés. Les autres communautés chrétiennes dissidentes possèdent peut-être (d’un simple point de vue matériel) quelques éléments en commun avec l’Eglise catholique (comme le baptême valide ou la profession de certaines vérités de foi). Mais d’un point de vue formel, elles se définissent en tant que telles dans leur refus du primat de l’évêque de Rome. Ce sont des « sectes », c’est à dire, étymologiquement, des pièces détachées de la vraie Eglise, et, comme telles, non pas des communions encore imparfaites mais des privations et des refus de communion. La prétendue communion encore imparfaite dont rêve Léon XIV à la suite de Vatican II, est en réalité une non-communion et c’est pourquoi elle ne pourra jamais atteindre à l’unité ecclésiale, c’est-à-dire à l’unité sociale de partie à partie en vue du même bien commun sous la direction d’une même autorité suprême, celle du Vicaire du Christ.
10. Pour nous résumer, voici notre argumentation théologique mise en forme :
Première prémisse majeure : l’unité de l’Eglise dont le chef visible ici-bas est le vicaire du Christ est celle de l’Eglise catholique romaine. Preuve de cette première prémisse : l’unique vicaire de Christ est l’évêque de Rome.
Deuxième prémisse mineure : or, l’unité de l’Eglise voulue par le Christ est celle de la société dont le chef visible ici-bas est le vicaire du Christ.
Conclusion : donc, l’unité de l’Eglise voulue par le Christ est uniquement celle de l’Eglise catholique romaine et ce n’est pas celle que nous décrit Léon XIV à la suite de Vatican II.
– V –
Léon XIV et la Primauté de l’Eglise de Rome
12. Dans le Discours du 17 juillet, Léon XIV va jusqu’à dire que « Rome, Constantinople et tous les autres sièges ne sont pas appelés à se disputer la primauté, pour ne pas risquer de nous retrouver dans la situation des disciples qui, le long du chemin, alors même que Jésus annonçait sa passion imminente, se disputaient pour savoir lequel d’entre eux était le plus grand (Mc IX, 33-37) ». Nous regrettons de devoir le dire, au détriment de la pensée du Pape, mais il est évident que le texte de l’Evangile est ici détourné de son sens et instrumentalisé pour servir de caution à une idéologie, celle de cette nouvelle ecclésiologie de Vatican II, dans la confusion la plus totale. En réalité, le sens du passage allégué est que le Christ interdit à ses disciples non pas l’autorité, mais l’esprit de domination, qui correspond à l’abus de l’autorité chez celui qui la possède. Et il est clair que, par la volonté du Christ, saint Pierre possède l’autorité sur les autres apôtres, et qu’il est de ce point de vue « plus grand » qu’eux. Il est également manifeste que le siège de Rome possède la primauté sur tous les autres. Ce sont là des dogmes de notre foi, rappelés en son temps par le concile Vatican I dans la constitution Pastor aeternus. Nous ne voyons pas comment concilier, avec la saine doctrine révélée par Dieu et rappelée par la définition solennelle de ce Concile, l’affirmation du Pape Léon XIV, telle qu’elle figure dans ce Discours du 17 juillet. D’autant moins que, dans les actes du concile de Constance, on trouve parmi les propositions condamnées de John Wyclif et de Jean Huss la suivante : « Il n’est pas nécessaire au salut de croire que l’Église de Rome est supérieure aux autres églises »[10].
– VI –
Grâces d’état ?
13. A la fin de la réflexion déjà citée [11], Monsieur Maugendre conclut en ces termes : « Fondamentalement personne ne semble savoir quelle perception a Léon XIV de l’acuité de la crise que vit l’Eglise, de ses causes et des remèdes à y apporter. Ce qui est certain c’est que lui seul a les grâces d’état pour gouverner la barque de Pierre ». Cela est certain, en effet, et Monsieur Maugendre a raison de nous le rappeler. Mais si nous nous basons sur les différents discours du Pape que nous avons rapportés plus haut, il semble plus que douteux que, à supposer qu’il ait conscience d’une crise dans l’Eglise, Léon XIV en voie la cause profonde dans les enseignements de Vatican II. Ce qui est hors de doute, en revanche, c’est que les grâces d’état n’ont jamais rendu personne ni clairvoyant ni infaillible ; et qu’elles ne font jamais l’économie de la liberté de celui qui les reçoit. Ces grâces d’état ne sont pas des grâces de miracle. Elles sont le secours que Dieu proportionne à la mission confiée par Lui en vue du bien commun de la société et de l’Eglise à celui qui en a la responsabilité. Elles signifient que, s’il use mal de sa liberté pour manquer à sa mission, celui qui aura tout de même bénéficié de ces grâces d’état sera d’autant plus sévèrement tenu pour responsable de son propre échec.
14. Dire que le Pape seul « a les grâces d’état pour gouverner la barque de Pierre » ne signifie pas que l’Eglise est à l’abri du mauvais gouvernement d’un mauvais Pape. Et cela ne doit certainement pas, non plus, rendre illégitime toute réaction de la part des fidèles, prêtres et évêques, eux aussi membres du Peuple de Dieu et du Corps mystique de Jésus Christ, dans le contexte d’un état de nécessité, où, en dépit de ces grâces d’état qui lui sont réservées à lui seul, le Pape scandalise l’Eglise en lui donnant à boire le poison mortel d’une nouvelle ecclésiologie œcuméniste et indifférentiste. Certes oui, Léon XIV est le seul à recevoir les grâces d’état réservées au successeur de Pierre pour gouverner l’Eglise. Mais les évêques ont eux aussi leurs grâces d’état, qui leur sont données pour assurer la pérennité du sacerdoce, en vue du salut des âmes. Ce sont ces grâces qui ont conduit Mgr Lefebvre à transmettre l’épiscopat à quatre de ses fils, pour accomplir « l’opération survie » de la Tradition et de l’Eglise. Et ce sont ces mêmes grâces qui pourraient conduire prochainement l’abbé Pagliarani à décider que le moment est venu de procéder à de nouvelles consécrations épiscopales, dans la Fraternité, toujours pour le même motif : continuer l’Eglise malgré ces germes d’auto-destruction que continue malheureusement d’entretenir la prédication du nouveau Pape, Léon XIV.
15. Quant au reste du Peuple de Dieu, il a la grâce suffisante pour prier sans relâche afin que, dans la fidélité aux grâces reçues, le Pape Léon XIV soit fidèle à sa mission, qui est de condamner enfin les faux principes de cette ecclésiologie empoisonnée.
Abbé Jean-Michel Gleize
[1] Voir les articles parus dans les numéros de mai 2016, mai 2017, septembre 2017, juillet-août 2018, octobre 2020, janvier 2023 et février 2023 du Courrier de Rome, ainsi que l’article paru sur la page du 3 janvier 2024 du site La Porte Latine.
[2] Voir les articles parus sur les page du 19 juillet et du 3 septembre 2021 du site La Porte Latine, ainsi que l’article paru dans le numéro de mai 2022 du Courrier de Rome.
[3] Cf. https://renaissancecatholique.fr/blog/leon-xiv-le-pape-de-lesperance/
[4] https://www.vatican.va/content/leo-xiv/fr/speeches/2025/may/documents/20250519-altre-religioni.html
[5] https://www.vatican.va/content/leo-xiv/fr/speeches/2025/june/documents/20250607-simposio-nicea.html
[6] https://www.vatican.va/content/leo-xiv/fr/speeches/2025/june/documents/20250628-patriarcato-ecumenico.html
[7] Voir l’article « Des évêques parlent » dans le présent numéro du Courrier de Rome.
[8] Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Couturier – Paul Couturier (1881-1953) dont les funérailles, présidées par le cardinal Gerlier, eurent lieu en présence de plusieurs pasteurs protestants fut le fondateur de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, qui rassemble dès 1939 les membres des différentes confessions catholiques, orthodoxes, anglicans et réformés et qui sera à partir de 1968 organisée conjointement par le Conseil œcuménique des Eglises et le Conseil Pontifical pour l’unité des chrétiens. En 1936, le Père Couturier suscite la première rencontre spirituelle interconfessionnelle à Erlenbach, en Suisse alémanique, entre des pasteurs réformés et des prêtres catholiques, point de départ du Groupe des Dombes, qui réunira ensuite, chaque année, quelque quarante théologiens, catholiques et protestants, pour un dialogue théologique œcuménique.
[9] Cf. Timothée Zapelena, sj, Le Corps et l’âme de l’Eglise d’après le magistère et la théologie, Courrier de Rome, 2013 : chapitre 2 (« Coextension du Corps mystique et de l’Eglise catholique romaine »), p. 43-64 ; 3e appendice (« L’unicité du sens révélé de l’expression du Corps mystique »), p. 73-79.
[10] 41e proposition condamnée lors de la 8e session, du 4 mai 1415 (DS 1191). Ce décret fut confirmé par le Pape Martin V dans la bulle Inter cunctas, du 22 février 1418 (Collection des actes des conciles établie par Mansi, t. XXVII, col. 1209).
[11] Cf. le n° 2 du présent article.